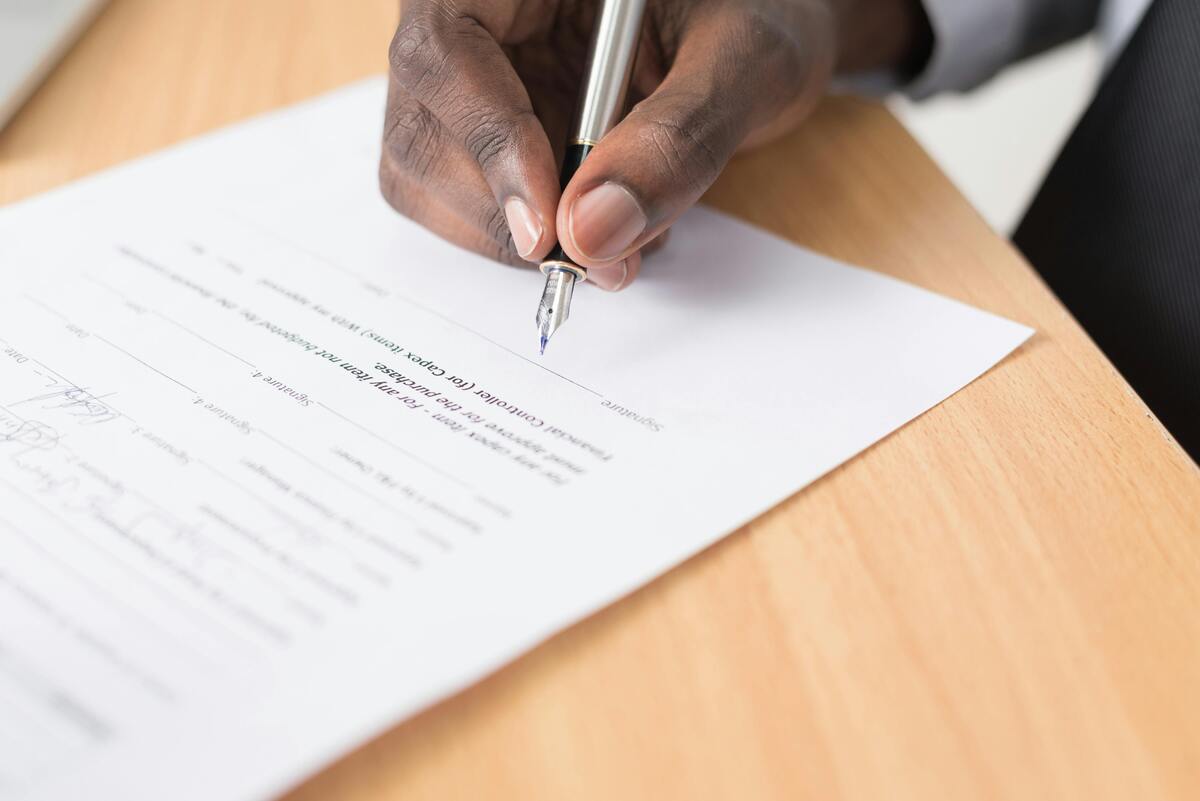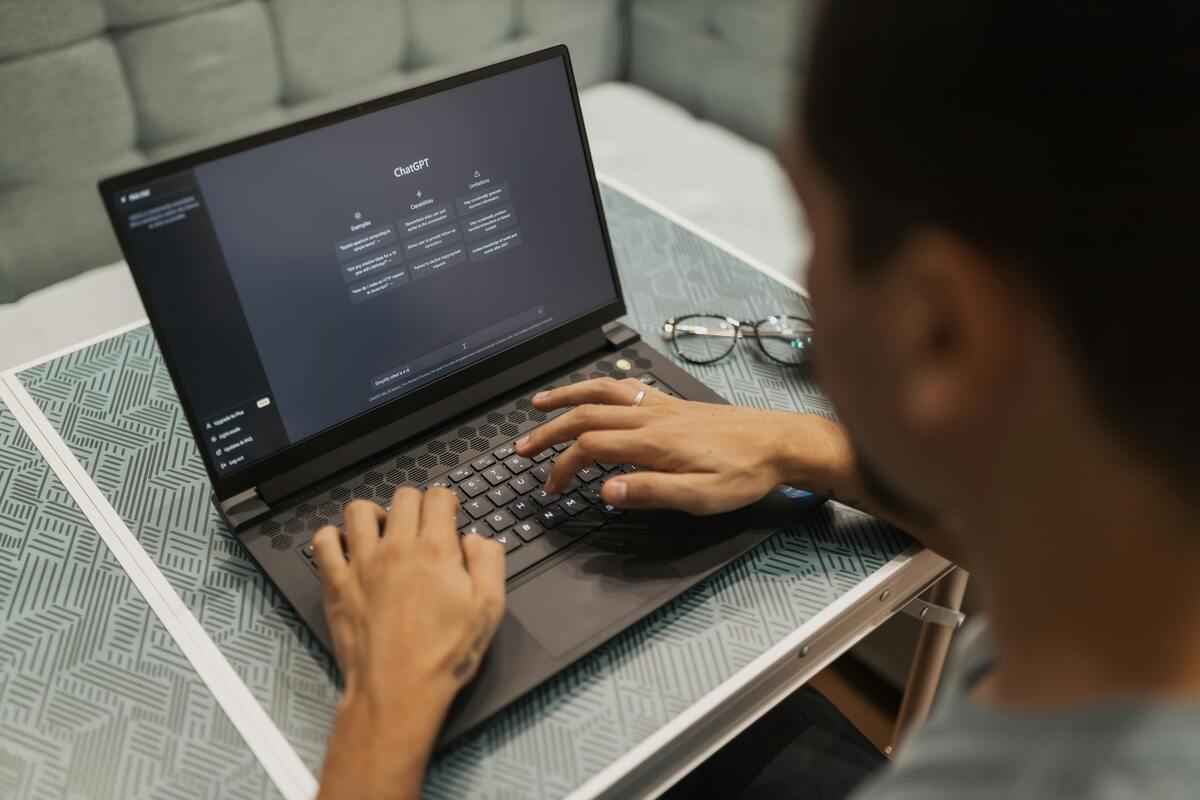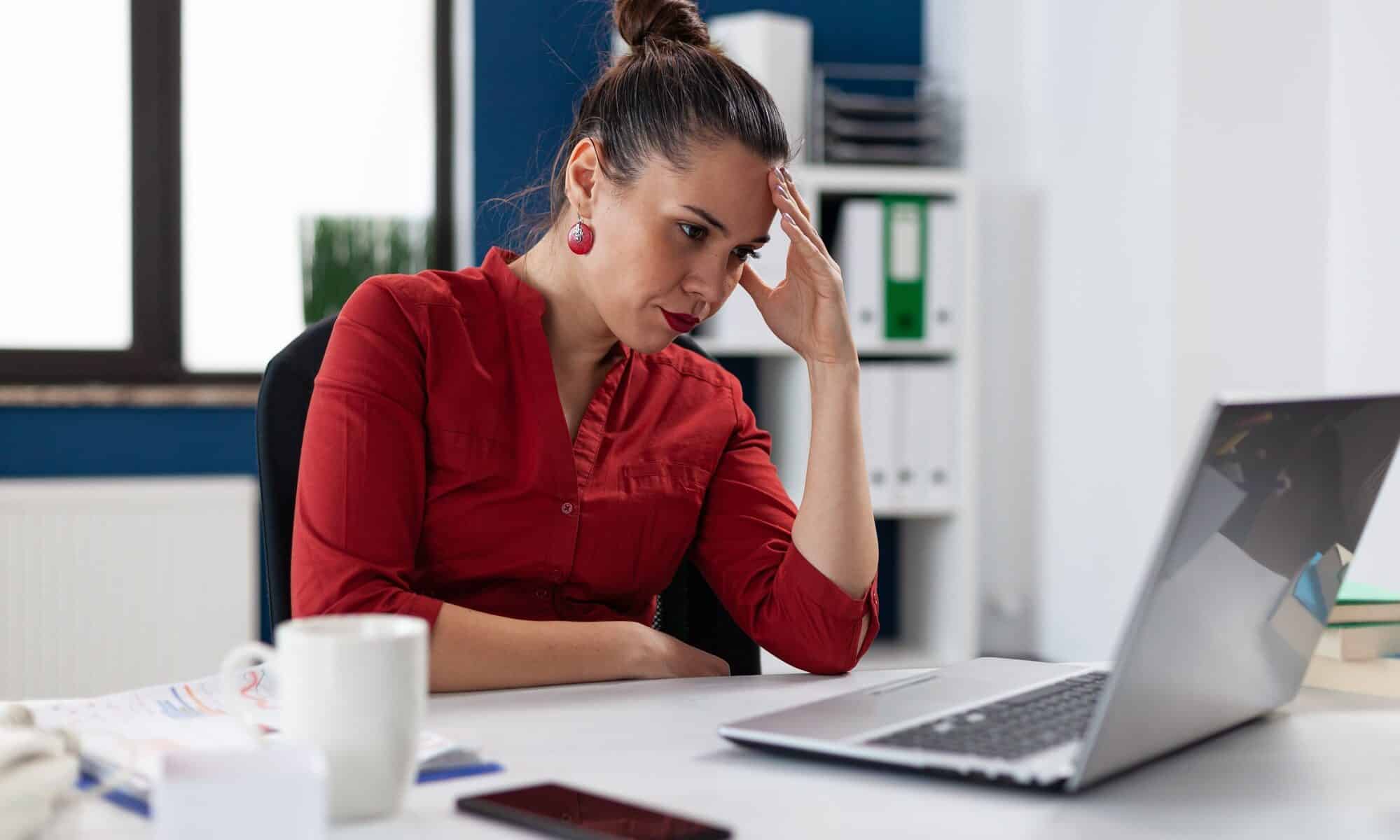Protéger les intérêts de l’entreprise, son savoir-faire, ses informations stratégiques ou ses relations clients est essentiel. Pour ce faire, deux outils juridiques sont souvent mobilisés : la clause de confidentialité et la clause de non-concurrence. Si elles poursuivent un objectif commun de protection, leur portée, leur durée et leurs implications sont très différentes. Alors comment les articuler efficacement ? Et surtout, comment les rédiger sans courir le risque d’illégalité ?
Clause de confidentialité : protéger l’information stratégique
La clause de confidentialité a pour objectif d’empêcher un salarié (ou un partenaire) de divulguer des informations sensibles pendant et après l’exécution du contrat. Elle concerne :
-
Les données techniques ou commerciales ;
-
Les fichiers clients ou fournisseurs ;
-
Les projets de développement ou de recherche ;
-
Toute information stratégique non publique.
Elle peut être incluse dans tout type de contrat : contrat de travail, contrat de prestation, pacte d’actionnaires…
💡 Aucun versement d’indemnité n’est requis pour cette clause, contrairement à la clause de non-concurrence.
Cependant, pour être valable, la clause doit être clairement rédigée, proportionnée et ne pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler dans son secteur : elle ne doit porter que sur la divulgation d’informations, pas sur l’activité elle-même.
Clause de non-concurrence : encadrer le départ du salarié
La clause de non-concurrence vise à empêcher un salarié de travailler pour un concurrent ou de créer une activité concurrente après la rupture du contrat. Elle est plus contraignante juridiquement et doit répondre à quatre conditions cumulatives pour être valable :
-
Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
-
Être limitée dans le temps et dans l’espace ;
-
Être proportionnée au poste occupé ;
-
Donner lieu à une contrepartie financière réelle et sérieuse.
La Cour de cassation annule régulièrement les clauses qui ne respectent pas ces critères. Le montant de la contrepartie financière ne peut être symbolique, et doit être versé après le départ du salarié, sauf renonciation expresse et formalisée.
Confidentialité et non-concurrence : deux clauses, deux finalités
Il est courant de cumuler ces deux clauses dans un même contrat. Encore faut-il bien distinguer leur objet :
-
La clause de confidentialité empêche de divulguer ;
-
La clause de non-concurrence empêche de travailler ailleurs ou de concurrencer.
La première peut durer indéfiniment, tant qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du travail. La seconde, en revanche, doit toujours être limitée dans le temps (souvent 12 à 24 mois) et compensée financièrement.
Un bon contrat distingue clairement les deux, en évitant les chevauchements inutiles ou les formules floues du type : « le salarié s’engage à ne pas utiliser ou diffuser les informations obtenues à des fins concurrentielles ». Cette formulation hybride pourrait être requalifiée en clause de non-concurrence déguisée… sans contrepartie.
Conseils pour une rédaction efficace et opposable
Pour sécuriser vos clauses, voici quelques recommandations concrètes :
-
Spécifiez précisément les informations visées par la clause de confidentialité ;
-
Définissez clairement la zone géographique, la durée et le champ d’application de la clause de non-concurrence ;
-
Prévoyez une contrepartie financière suffisamment motivée, calculée en pourcentage du salaire antérieur (souvent entre 20 et 50 %) ;
-
Insérez une clause de renonciation à la non-concurrence, activable à la fin du contrat, pour plus de flexibilité ;
-
Ne cumulez pas des interdictions disproportionnées : le juge annule l’ensemble en cas d’abus.
Enfin, tenez compte du contexte : les clauses valables pour un cadre dirigeant ne seront pas identiques à celles d’un commercial ou d’un technicien spécialisé.
Deux clauses à manier avec précision
Confidentialité et non-concurrence ne doivent pas être confondues. Bien rédigées, elles permettent de protéger efficacement les intérêts stratégiques de l’entreprise sans pour autant restreindre abusivement la liberté professionnelle des salariés ou prestataires.
Chez Avocat Desrumaux, nous accompagnons les entreprises dans la rédaction sur-mesure de clauses protectrices, adaptées à chaque profil, chaque secteur et chaque niveau de risque. Notre approche : allier sécurité juridique, clarté rédactionnelle et efficacité opérationnelle.
Vous souhaitez auditer ou sécuriser vos clauses contractuelles ? Contactez notre cabinet pour un accompagnement juridique personnalisé.